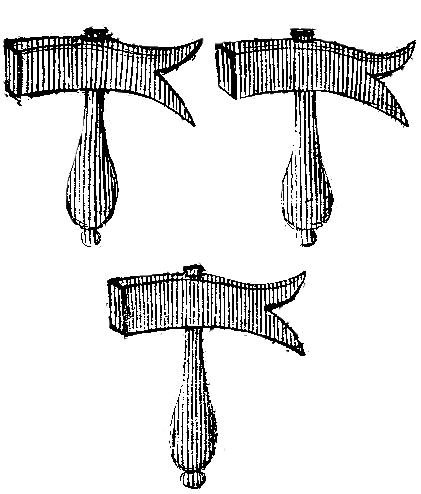L’année 1848 vue par le Mémorial Artésien
1848 vue par le Mémorial
1848 commence par un discours du roi Louis-Philippe
se termine sur un discours du président Louis Napoléon Bonaparte
entre les deux, une révolution et une révolte sanglante
La situation en 1847 est difficile. Le prix du pain, le manque de travail. « Au milieu de la crise difficile que nous traversons… » (le 15 mai 1847). « Par suite du dernier marché, les boulangers ont fait subir une hausse au prix du pain… » (le 5 juin).
Le 28 décembre 1847, le Roi dans son discours devant les Chambres semble voir les difficultés comme surmontées. « Je suis heureux, en me retrouvant au milieu de vous, de n’avoir plus à déplorer les maux que la cherté des subsistances a fait peser sur notre patrie… »
1848, le 26 février dans sa publication, le Mémorial montre une inquiétude : « Depuis près de 48 heures, au moment où nous mettons sous presse, nous sommes sans nouvelles de Paris. Ni lettres, ni journaux ! »
Mais plus loin :
nouvelles politiques étrangères.
France. – Le banquet réformiste du 12e arrondissement de Paris devait avoir lieu mardi 22 de ce mois, mais un arrêté de Monsieur le préfet de police y a mis obstacle.
– Le comité directeur du banquet ayant publié un manifeste réglant l’ordre de la marche du cortège, et, y assignant des places précises à la garde nationale et aux écoles conviées d’assister à cette manifestation, le gouvernement a vu, dans ce manifeste, une illégalité et une usurpation de pouvoir ; il a en conséquence défendu le cortège qu’on préparait, et cela, d’une manière formelle et sous les peines et conséquences édictées par les lois sur les rassemblements et les émeutes.
– L’arrêté de Monsieur le préfet de police ayant été affiché en même temps qu’une proclamation de Monsieur le général Jacqueminot à la garde nationale parisienne, engageant les gardes nationaux à ne pas se rendre à l’appel illégal du comité réformiste, Monsieur Odilon Barrot se rendit à la chambre qui siégeait en ce moment et de sa place il interpella le ministère pour qu’il eut à s’expliquer sur ce qui se passait, sur le manque de parole à la suite duquel on empêchait un banquet qu’on avait promis à l’opposition de laisser faire, sauf à s’en rapporter plus tard, sur la question même, à l’appréciation des tribunaux.
– Monsieur Duchatel prit la parole et répondant à Monsieur Odilon Barrot, il lui démontra que l’opposition était dépassée par le comité réformiste dont le manifeste sortait de toute position légale, et que dans cette grave occurrence le gouvernement se croyait dans l’absolue nécessité de faire respecter les lois ; sommé par le ministre de déclarer s’il approuvait le manifeste du comité, le chef de la gauche n’osa pas prendre sur lui cette approbation, mais il rejeta sur le ministère l’éventualité des malheurs qui pourraient être la suite de sa dernière résolution de mettre obstacle à la manifestation réformiste.
– Pourtant Monsieur Odilon Barrot fit entendre que les députés de l’opposition n’assisteraient pas au banquet et la séance de la chambre fut levée au milieu d’une vive agitation ; car si Monsieur Odilon Barrot rejetait d’avance sur le ministère la responsabilité des faits futurs, la majorité lui répondait que les chefs et les auteurs de l’agitation devaient à ses yeux porter la peine de cette responsabilité.
– A la suite de cette séance de la chambre, le comité réformiste, averti par Messieurs les députés de l’opposition qu’ils ne se rendraient pas au banquet, le comité, disons-nous, décida que le banquet n’aurait pas lieu ; mais en même temps les journaux de l’opposition déclarèrent qu’un certain nombre de députés étaient décidés à déposer en leur nom sur le bureau de la chambre, la proposition de mise en accusation du ministère.
Ici finit la première phase de ce drame politique ;
Voici la seconde :
On le comprend, après ces préliminaires plus encore qu’avant eux, l’inquiétude la plus profonde, la plus légitime devait régner dans Paris, dans cette capitale qui, tête du royaume, par le commerce, par l’industrie, par les arts et plus encore par la concentration du pouvoir, étend sa pensée, son influence, et souvent même sa résolution, son parti pris, sur tout le reste du pays.
– Cependant jusqu’au mardi 23 février le plus grand calme régna dans Paris, mais seulement jusqu’à 10 heures du matin.
À 10 heures, sur la place de la Madeleine, l’affluence était immense, les boutiques étaient fermées, pourtant l’attitude de la multitude était calme.
– À 11h30 un escadron de la garde nationale a chargé sur des groupes nombreux qui, après avoir été dissipés, se reformaient immédiatement.
– On a crié devant le ministère des affaires étrangères : à bas Guizot ! Vive la réforme ; des détachements de la ligne, des dragons et de la garde municipale ont été appelés pour protéger l’hôtel du ministre. À midi les députés, munis de leurs médailles ne pouvaient qu’à grand-peine traverser la foule et les rangs des gardes municipaux, pour se rendre à la chambre, gardée de tous côtés par des détachements de troupes de ligne et de cavalerie.
– À 2 heures la foule était immense sur la place de la Concorde. Des pierres avaient été jetées aux gardes municipaux ; des charges eurent lieu alors dans les Champs-Élysées.
– Plusieurs malheurs fort regrettables en furent la conséquence inévitable.
– A 5 heures, les troupes parties de plusieurs points à la fois dispersèrent les groupes qui se tenaient sur la place de la Concorde.
– Pendant ces événements, un commencement de barricades avait été tenté entre l’église Saint-Roch et l’Assomption.
– Dans le bas de la rue de Richelieu la boutique de Monsieur Lepage, armurier, avait été enfoncée et pillée, mais on n’y avait guère trouvé d’armes dont ont pu faire usage ; on assurait vers 6 heures que la boutique de Monsieur Dewismes, autre armurier, boulevard des Italiens, avait été également enfoncée et pillée.
– À 7 heures du soir vers les portes Saint-Denis et Saint-Martin, la circulation était interrompue et la boutique d’un armurier était mise au pillage.
– À 6 heures, pour la première fois de la journée, le tambour avait battu le rappel de la garde nationale.
– À 8 heures, une colonne composée de plus de 2000 personnes, dont quelques-unes armées de fusils, de piques et de couteaux attachés au bout de longs bâtons se portait vers le quartier du Marais, se faisait ouvrir les maisons et y prenait à tous les étages toutes les armes qu’elle trouvait à sa convenance ; etc.
Ce rassemblement arrivé dans les abords de la rue Saint-Louis élevait des barricades sur plusieurs points.
– Mais les troupes avaient été appelées dans ce quartier et bientôt plusieurs groupes se virent environnés de toutes parts ; des pièces de canon étaient dirigées sur ce point ; les premières barricades étaient attaquées et tout faisait craindre de terribles scènes, des résultats plus terribles encore.
Le jour même Monsieur Odilon Barrot avait déposé, sur le bureau de la chambre, une proposition de mise en accusation du ministère.
Les troubles continuent et les barricades aussi, une grande insurrection se dresse dans Paris… La garde nationale crie à bas le ministère ! Vive la réforme !
Monsieur Guizot monte à la tribune de la chambre des députés et annonce que le roi vient de faire appel à Monsieur le Comte Molé et de le charger de composer un nouveau ministère… Cette nouvelle se répand comme l’éclair dans la capitale et le calme renaît en partie.
– Il est en ce moment 4h30, on cite parmi les membres du nouveau ministère Messieurs Mollet, Dufaure, Billaut, Passy, Vivien… On ajoute que la chambre sera dissoute.
– On parle de réforme électorale, de réforme parlementaire, de révision de la loi des annonces judiciaires… Les troupes sont rentrées dans leurs casernes, mais la tranquillité ne paraît pas encore bien rétablie.
Mémorial du 1er mars 1848
Monsieur Molé ayant annoncé au roi Louis-Philippe, qu’il ne pouvait réussir à composer un cabinet qui put répondre aux exigences de la situation, Monsieur Thiers s’est rendu au château des Tuileries et a accepté la présidence du conseil avec Monsieur Odilon Barrot pour collègue à l’intérieur.
La nouvelle de cette modification ministérielle a été, dès 6 heures du matin, notifiée officiellement aux diverses légions de la garde nationale, et répandue par tous les moyens dans Paris.
Messieurs Thiers et Odilon Barrot avaient accepté la mission de rétablir le calme dans la capitale, en demandant le renvoi des troupes, et ils se sont empressés d’aller eux-mêmes l’annoncer aux légions de la garde nationale et aux groupes de citoyens répandus dans toutes les parties de la ville. C’est ainsi que Monsieur Odilon Barrot, accompagné d’un officier d’état-major, est allé lui-même à cheval jusqu’à la porte Saint-Denis, haranguant tous les rassemblements qu’il rencontrait, et invitant les citoyens à rentrer dans le calme.
Toutefois, les efforts de Messieurs Thiers et Barrot ne devaient pas être couronnés de succès, et la situation devenait plus grave de moment en moment, aussi vers 11h30, le roi Louis-Philippe, désespérant de voir le calme se rétablir, s’est décidé à signer une abdication en faveur de son petit-fils le comte de Paris, avec la régence de madame la duchesse d’Orléans.
Aucune de ces combinaisons n’a pu réussir. À ce moment déjà le combat avait cessé à peu près partout ; les troupes avaient déposé les armes, les avait remises au peuple, et à peine le roi Louis-Philippe avait-il eu le temps de quitter Paris, que la foule victorieuse se précipitait dans les appartements du château.
Tout le mobilier qu’il contenait a été précipité par les fenêtres ; un grand nombre de voitures ont été livrées aux flammes, dans les cours du château, comme la plus grande partie du mobilier. Ce soir, de grands feux sont encore entretenus avec les débris de tout ce qui garnissait le château.
Les mêmes scènes se sont passées au Palais-Royal. Les grands appartements ont été vidés de ce qu’ils contenaient ; mais les appartements particuliers ont été respectés.
À la séance de la chambre des députés, en date du 24 février, 300 députés environ étaient présents ; voici en résumé le compte rendu de cette séance.
A 1h15 Monsieur Lacrosse, député, secrétaire de la chambre, annonce que madame la duchesse d’Orléans, suivie de ses 2 enfants, se rend à la chambre. On aperçoit sur le pont de la Révolution la duchesse à pied, suivie d’une foule immense de gardes nationaux ; elle est introduite. On place au pied de la tribune 3 fauteuils, la duchesse y prend place avec ses 2 fils ; – elle est entourée d’une foule de généraux et d’aides de camp en grand costume. – Monsieur le duc de Nemours est en uniforme de lieutenant général. – Monsieur Dupin monte à la tribune ; il annonce que le roi a quitté Paris et qu’il a abdiqué en faveur de son petit-fils, Monsieur le comte de Paris. – Il est trop tard Monsieur, lui répond-on des tribunes. Messieurs Marie, Crémieux, Odilon Barrot, de la Rochejacquelin, montent successivement à la tribune.
En ce moment un flot populaire entre par toutes les issues de la chambre.
– Madame la duchesse d’Orléans se lève et semble vouloir parler. « Messieurs, dit Monsieur Lamartine, nous venons d’assister à un touchant spectacle ; nous avons vu ici, au pied de la chambre, une auguste princesse et ses 2 fils… Mais un tel spectacle ne peut nous faire oublier les droits sacrés du peuple ; il lui faut un gouvernement provisoire, fort, populaire, puissant.
En ce moment la chambre est envahie par les combattants armés ; Monsieur Sauzet quitte le fauteuil, les députés sortent à la hâte. La duchesse presque évanouie et ses fils sont emmenés au milieu d’une double haie de gardes nationaux… Monsieur le duc de Nemours les suit… On lui fait revêtir une redingote bourgeoise, et sachant que la duchesse d’Orléans et ses enfants sont en sûreté, il s’élance par une fenêtre dans le jardin de la chambre. – La séance est terminée.
Le Progrès, dans son numéro du 29 février, dit que l’Élysée-Bourbon et Neuilly ont été brûlés, mais ajoute-t-il, la vengeance du peuple n’a porté que sur les propriétés qui appartiennent à la famille d’Orléans, elle a respecté toutes les autres. – Le Progrès dit ensuite que le peuple cessera de s’en prendre à ce que Louis-Philippe n’a pu emporter avec lui, lorsqu’il saura que toutes les propriétés de Louis-Philippe viennent d’être placées sous le séquestre par un décret du gouvernement provisoire, jusqu’à ce qu’elles aient été légalement incorporées au domaine national.
Un gouvernement provisoire est formé, composé de : MM. Dupont, président du Conseil, Lamartine, affaires étrangères, Crémieux, Arago, marine, Ledru-Rollin,Intérieur, Bedeau, guerre, Garnier-Pagès, Maire de la ville de Paris, Marie, Travaux publics, Carnot, instruction publique et cultes, Cavaignac, gouverneur général de l’Algérie, Goudchaux, finances, Bethmont agriculture et commerce, . Les secrétaires : Armand Marrast, Louis Blanc, Ferdinand Flocon, Albert.
À Saint-Omer : Proclamation Hôtel de Ville de Saint-Omer : « L’administration municipale de Saint-Omer s’étant retirée, M. le Commandant de la garde nationale, en vue d’assurer le maintien de l’ordre public, nous a appelés à diriger provisoirement les affaires de la cité. »
Mémorial du 4 mars 1848.
La fuite du roi Louis-Philippe.
« L’ex roi est arrivé à Dreux, le 24 février, à 11h30 du soir, accompagné de la reine, de la duchesse de Nemours et de ses enfants.
Ils y avaient conservé le plus strict incognito, lorsque le nom du roi fut prononcé par mégarde par le seul valet de pied qui les accompagnait. Il y avait pour toute suite 2 femmes de chambre.
Vers une heure, le duc de Montpensier est arrivé, annonçant la déchéance de toute la famille sans aucun espoir.
Ils furent tous consternés à cette nouvelle.
L’ex roi et sa famille ont quitté Dreux le vendredi 25, à 9 heures du matin. Afin de cacher leur départ, le valet de pied, qui occupait le siège avait quitté la livrée et s’était revêtu d’une redingote et autres effets achetés 2 heures auparavant.
Le sous-préfet attendait la voiture à sa sortie de la ville et a pris place sur le siège à côté du valet de pied.
Les gendarmes de Saint-André ayant demandé, au relais de la poste de leur localité, quelles étaient les personnes que cette voiture renfermait, le sous-préfet est descendu immédiatement de son siège, leur a répondu à l’oreille, et les gendarmes se sont retirés immédiatement.
L’ex roi avait à peine traversé la forêt d’Anette, que les ouvriers d’une papeterie voisine arrivaient sur la route avec l’intention de les arrêter.
– A son arrivée à Versailles, Louis Philippe et sa suite ne trouvant pas de chevaux de poste, furent obligés de demander des chevaux à un régiment de cavalerie. La fuite avait été si rapide et si imprévue qu’il fallut faire à Trianon une collecte qui produisit 200 Fr. ; ce fut avec cette somme qu’il pût prendre la route d’Eu où il s’est embarqué pour l’Angleterre.
– Le duc de Nemours, après être resté 24 heures à Boulogne, déguisé en matelot, a pu s’embarquer pour Douvres où il est arrivé dimanche soir. Sa femme y est arrivée aussi ; ses bagages ont été saisis à Boulogne. Le duc de Montpensier était attendu à Douvres.
– Un voyageur qui arrive d’Angleterre nous apprend que Monsieur Guizot est débarqué à Douvres dimanche matin. Le bâtiment qui portait sa fortune a essuyé une effroyable tempête. 2 passagers et un matelot ont péri dans la traversée. Monsieur Guizot, plus heureux, est arrivé sain et sauf. Il avait gardé l’incognito à bord.
Le même voyageur a entendu dire que Louis-Philippe était débarqué à Brighton. La nouvelle de sa mort ne se confirme pas.
– Un témoin oculaire de la fuite de Louis-Philippe et de la reine, en fait le récit en ces termes :
Vers une heure de l’après-midi, pendant que je causais avec le colonel du 21e de ligne, qui manifestait les plus patriotiques dispositions, dont il a fait preuve aussitôt en ordonnant à ses soldats de remettre la baïonnette au fourreau, un jeune homme, vêtu en bourgeois, accouru au grand trot de son cheval en criant que Louis-Philippe venait d’appliquer, et demandant qu’on en répandit la nouvelle. Ce jeune homme était le fils de l’amiral Baudin. Peu d’instants après, au Pont-Tournant, nous vîmes déboucher du jardin des Tuileries des gardes nationaux à cheval, allant au pas, comme la tête d’un cortège, et invitant du geste et de la voix les citoyens à s’abstenir de toute manifestation défavorable ; on entendit même ces mots, partis de leur côté : une grande infortune.
Alors, je vis sortir de la grille des Tuileries, au milieu des cavaliers, et suivi de près par une trentaine de personnes portants différents uniformes, Louis-Philippe à pied, son bras droit passé dans le bras gauche de la reine, sur lequel il s’appuyait assez fortement, et celle-ci, marchant d’un pas ferme et jetant des regards à la fois assurés et colères sur tout ce qui les entourait.
Louis-Philippe était en habit noir, avec un chapeau rond et sans aucun insigne. La reine portait le grand deuil. On disait qu’ils se rendaient à la chambre des députés pour y déposer l’acte d’abdication. Malgré l’avis qu’on avait donné, des cris se firent entendre ; on distinguait ceux de vive la réforme ! Vive la France ! Et 2 ou 3 voix y mêlaient ceux de vive le roi ! Dès qu’on eut dépassé le terrain qui formait autrefois le Pont-Tournant, et à peine parvenus à l’asphalte qui entoure l’obélisque, Louis-Philippe, la reine et le groupe tout entier s’arrêtèrent, sans que rien n’en indiquât la nécessité. Tout à coup ils furent enveloppés, tant des personnes à pied que de celles à cheval, et tellement pressés qu’ils n’avaient plus la liberté de leurs mouvements. Louis-Philippe parut effrayé de cette soudaine approche.
En effet, la place était fatalement choisie par le hasard, et cette halte prenait une étrange signification : à quelques pas de là un roi Bourbon eût été bien heureux de n’éprouver qu’un traitement semblable ! Louis-Philippe se retourna vivement, en quittant le bras de la reine, prit son chapeau, le leva en l’air et prononça une phrase que le bruit qui se faisait empêcha d’entendre. On criait sans articuler d’opinions, les chevaux caracolaient autour du groupe, le pêle-mêle était général. La reine s’alarma de ne pas sentir le bras qu’elle soutenait, et se retourna avec une extrême vivacité, en parlant de même. Je crus devoir alors lui dire : « Madame, ne craignez rien ; continuez, les rangs vont s’ouvrir devant vous. »
Le trouble où elle était lui fit-il mal interpréter mon intention et mon mouvement ? Je l’ignore ; mais repoussant ma main : « laissez-moi ! » S’écria-t-elle avec un accent des plus irrités. Puis, elle saisit le bras de Louis-Philippe, et ils retournèrent sur leurs pas, à très peu de distance de là, ou stationnaient 2 petites voitures noires, basses et attelées chacune d’un cheval. 2 très jeunes enfants se trouvaient dans la première. Louis-Philippe prit la gauche, la reine la droite ; les enfants se tinrent debout, le visage collé sur la glace et regardant le public avec une attention curieuse. Le cocher fouetta vigoureusement, la voiture s’enleva plutôt qu’elle ne partit ; elle passa devant moi et déjà elle était entourée et suivie de toute la cavalerie présente, gardes nationaux, cuirassiers et dragons, lorsque la seconde voiture, où se placèrent 2 dames que l’on disait des princesses, essaya de rejoindre la première. L’escorte était nombreuse ; il m’a semblé qu’on pouvait l’évaluer à 200 hommes.
– En sortant de la chambre des députés, la duchesse d’Orléans s’était rendue à l’Hôtel des Invalides, qu’elle a quitté à 6h30, à pied, sans argent, accompagnée d’une seule personne en bourgeois et tenant le comte de Paris par la main.
– On lit dans le Siècle : « on sait la dévastation du château de Neuilly. On nous raconte un terrible épisode de ce drame sanglant. Les bandits, après avoir forcé les portes, se précipitèrent les uns dans les appartements, les autres dans les caves. Ces derniers trouvèrent des vins de toutes sortes et un baril de rhum dont ils brisèrent une douve à coups de hachette. Quelques instants après, les dévastateurs étaient tous ivres ; une scène terrible s’engagea alors entre eux ; un combat terrible eut lieu ; les 100 ou 130 hommes entrés dans les caves se bâtirent à coups de bouteilles, et bientôt enivrés, blessés, ils tombèrent et s’endormirent.
Mais pendant cet incident les hommes qui étaient restés dans les appartements, après avoir tout pillé ou dévasté, mirent le feu au château et se retirèrent. Bientôt l’incendie acquit une telle violence, qu’il devint impossible de le maîtriser. Les flammes ne tardèrent pas à dévorer les bâtiments, et les 100 malheureux endormis dans les caves périrent ou dévorés par le feu ou asphyxiés par la fumée. En déblayant les caves, on a retiré 100 ou 120 cadavres, dont plusieurs portaient encore sur le visage les traces des coups de bouteilles qu’ils avaient reçus.
Mémorial du 8 mars
Nous avons reçu les journaux anglais d’hier matin et hier soir. Le roi Louis-Philippe et la reine Amélie sont arrivés à Brighton le 5 mars et sont en ce moment à Londres.
Nous avons lu avec un douloureux intérêt le récit que font les journaux anglais des derniers jours que la famille d’Orléans a passés sur la terre de France. Après avoir erré de ferme en ferme dans les environs du Tréport, le roi et la reine se sont embarqués sur un bateau pécheur et ont été recueillis en mer par un bateau à vapeur. On sait le temps épouvantable qui a régné. – Monsieur Guizot est arrivé à Londres, par Douvres. – Monsieur Duchâtel est arrivé à Brighton.
Le prince Louis Bonaparte vient de quitter Paris, où il était depuis quelques jours à peine ; dans une lettre rendue publique il a déclaré qu’il s’empressait de se retirer, puisque sa présence à Paris paraissait être un obstacle au gouvernement provisoire.
Mémorial du 11 mars
Au moment, dit-on, où l’ex roi Louis-Philippe, descendait du bateau à vapeur l’Express il se serait écrié : « Dieu merci, me voilà sur le sol britannique. » Descendu dans un hôtel de Newhaven, il a reçu différentes personnes.
Causant dans la soirée avec quelques habitants de Brighton, Louis-Philippe s’est mis à parler avec abondance de la révolution, et il aurait dit à cette occasion : « Charles X a été détrôné pour avoir brisé la Charte, et moi je suis renversé pour l’avoir défendue, pour avoir gardé mon serment ! » Durant toutes ces visites et ces démonstrations, Marie-Amélie restait silencieuse, absorbée dans ses pensées, remarquant à peine ce qui se passait dans la salle.
Le roi Louis-Philippe et la reine ne sont pas allés à Londres. Ils ont quitté Brighton par le chemin de fer, mais se sont arrêtés à Croydon, près de Londres, où des voitures les attendaient. De là ils sont partis directement pour Claremont, le château du roi des Belges.
Mémorial du 3 juin publie « Les 2 Républiques » de Victor Hugo.
Mes concitoyens,
je réponds à l’appel des 60 000 électeurs qui m’ont spontanément honoré de leurs suffrages aux élections de Paris. Je me présente à votre libre choix.
Dans la situation politique telle qu’elle est, on me demande toute ma pensée ; la voici :
Deux républiques sont possibles.
L’une abattra le drapeau tricolore sous le drapeau rouge, fera des gros sous avec la colonne, jettera bas la statue de Napoléon et dressera la statue de Marat, détruira l’Institut, l’École polytechnique et la Légion d’Honneur, ajoutera à l’auguste devise : Liberté, Égalité, Fraternité, l’option sinistre : ou la Mort, fera banqueroute, ruinera les riches sans enrichir les pauvres, anéantira le crédit, qui est la fortune de tous, et le travail, qui est le pain de chacun, abolira la propriété et la famille, promènera des têtes sur des piques, remplira les prisons par le soupçon et les videra par le massacre, mettra l’Europe en feu et la civilisation en cendres, fera de la France la patrie des ténèbres, égorgera la liberté, étouffera les arts, décapitera la pensée, niera Dieu ; remettra en mouvement ces 2 machines fatales qui ne vont pas l’une sans l’autre, la planche aux assignats et la bascule de la guillotine ; en un mot, fera froidement ce que les hommes de 93 ont fait ardemment, et, après l’horrible dans le grand que nos pères ont vu, nous montrera le monstrueux dans le petit.
L’autre sera la sainte communion de tous les Français dès à présent, et de tous les Peuples un jour, dans le principe démocratique, fondera une liberté sans usurpations et sans violences, une égalité qui admettra la croissance naturelle de chacun, une fraternité, non de moines dans un couvent, mais d’hommes libres ; donnera à tous l’enseignement comme le soleil donne la lumière, gratuitement ; introduira la clémence dans la loi pénale et la conciliation dans la loi civile ; multipliera les chemin de fer, reboisera une partie du territoire, en défrichera une autre, décuplera la valeur du sol ; partira de ce principe, qu’il faut que tout homme commence par le travail et finisse par la propriété ; assurera en conséquence la propriété comme la représentation du travail accompli et le travail comme l’élément de la propriété future ; respectera l’héritage, qui n’est autre que la main du père tendue aux enfants à travers le mur du tombeau ; combinera pacifiquement pour résoudre le glorieux problème du bien-être universel, les accroissements continus de l’industrie, de la science, de l’art et de la pensée ; poursuivra, sans quitter la terre pourtant, et sans sortir du possible et du vrai, la réalisation sereine de tous les grands rêves des sages ; bâtira le pouvoir sur la même base que la liberté, c’est-à-dire sur le droit ; subordonnera la force à l’intelligence ; dissoudra l’émeute et la guerre, ces 2 formes de la barbarie ; fera de l’ordre la loi des citoyens et de la paix la loi des nations, vivra et rayonnera, grandira la France, conquerra le monde, sera, en un mot, le majestueux embrassement du genre humain sous le regard de Dieu satisfait.
De ces deux républiques, celle-ci s’appelle la civilisation, celle-là s’appelle la terreur. Je suis prêt à dévouer ma vie pour établir l’une et empêcher l’autre.
Paris, 26 mai 1848. Victor Hugo
Mémorial du 10 juin
D’une lettre récemment écrite par le Comte de Neuilly (Louis-Philippe) à un de ses anciens aides-de-camp, le général X, nous extrayons les passages suivants :
« c’est mercredi matin, 17 mai, que nous avons appris à Londres les événements de lundi, votre honorée m’est bien parvenue sous le couvert de D. – Les détails intimes que vous me donnez, et qui ne sont pas dans les feuilles publiques, m’ont occasionné le plus grand plaisir.
Le coup de main tenté sur l’Assemblée nationale a été très hardi, je l’avoue, mais il a été fait par des hommes sans aucune consistance politique. La plupart étaient des lapins vidés ; d’autres, des outres remplies de vin blanc, et vous savez qu’il réagit sur les nerfs, surtout le lundi. Plusieurs étaient sans présent, avec un triste passé sur leur conscience. Le plus capable, comme le plus audacieux, c’est Blanqui. Mais c’est un fou qu’on a rendu furieux. Il sera très dangereux pour l’avenir. Ce n’est pas un homme qu’on gagnera avec des places ; il s’en moque. C’est, entre nous, un mauvais coucheur politique.
Hubert est une espèce de butor. J’ai beaucoup ri quand j’ai lu dans votre lettre qu’il s’était nommé ministre des finances ; cet homme qu’on dit barbu comme le
Juif-Errant est le côté plaisant de la chose. Quant à Barbès, à qui j’ai fait grâce malgré mes ministres, c’est un Gascon républicain ; s’il avait eu 2 onces de bon sens, il se serait tenu tranquille avec ses 25 Fr. par jour de représentant et son grade de colonel ; mais c’est précisément les plus sots qui, en temps de révolution, se croient les plus capables.
Quand à Courtais, il me semble avoir entendu parler d’un garde du corps de ce nom, c’est un homme d’un certain âge, on le croit coupable : je pense moi, que les malins de la chose lui ont fait jouer le rôle de Cassandre.
Que va-t-on faire de toute cette bande rouge qu’on appelle les voraces, les moutons sans laine et les batteurs d’or ? Dans un pays aussi intelligent, tout ça est bien triste, mon cher général.
Lamartine est sans contredit un homme de talent, mais il n’a pas de sens politique ; son mariage avec Monsieur Ledru-Rollin est une bêtise ; moi, qui ai fait des bêtises que je reconnais à présent, j’ai bien le droit de dire ma façon de penser. Puisque le pays voulait être républicain malgré lui, il fallait que Lamartine profitât du coup de soleil qu’il avait donné à la France pour s’asseoir sur le fauteuil de la présidence ; mais cet homme, qui est courageux, n’est pas ferme ; il ne craint pas une balle, il ne saurait pas résister à un coup d’audace. Le plus roué de tous, c’est le petit Blanc, il a du Thiers, du Talleyrand ; il est, je suis sûr, orgueilleux et rageur comme tous les hommes de petite taille. Comment les ouvriers ne voient-ils pas que ce n’est pas l’organisation du travail qu’il a à cœur, mais bien le ministère du travail ?
Il paraît que la mairie de Paris est dans un désordre impossible à décrire ; Rambuteau dépensait beaucoup en administration, mais le navire était au moins un peu propre ; depuis février on y a gaspillé 3 fois plus que de notre temps, en bons de toute espèce.
J’espère que les gens du National ne se plaindront pas, ils ont tout accaparé ; pour des gens aussi vertueux, la curée des places n’aurait pas dû exciter autant leurs appétits ; mais, mon cher ami, tous les hommes sont les mêmes, et tout le patriotisme du National a consisté, pendant 17 ans, à se résumer en ces mots : ôte-toi de là que je m’y mette. Leur patron Marrast crie dans ce moment à la réaction, c’est une finasserie cousue de fil blanc ; il tient à la place de maire, et voilà tout ; quelques-uns des miens connaissent l’homme, c’est un marquis hautain avec une écharpe tricolore et un chapeau de conventionnel.
Ah ! Si je n’avais pas eu cette confiance aveugle que donnent 17 ans de règne, si je n’avais pas cru que la charte fût une vérité, si autour de moi, si moi-même, je n’avais pas perdu la tête, j’aurais fait ce qu’a eu l’esprit de faire la garde nationale ; j’aurais été cerner l’hôtel de ville, et j’aurais mis la main sur le gouvernement provisoire ; mais je n’ai pas voulu faire tirer sur le peuple… Il m’en a bien récompensé.
Quand on a passé comme moi par tant d’étamines, on devient philosophe. Mon cher général, le croiriez-vous, je me surprends quelquefois à chanter la Marseillaise. Je plaisante quelquefois sur les vicissitudes humaines. Mes enfants sont tristes, l’inactivité les tue, Joinville surtout ; vous savez comment il aimait le mouvement.
J’espère, mon cher général, que vous viendrez me voir avant peu. Paris ne sera pas tranquille de longtemps, les Montagnards tenteront encore quelque nouveau coup de main sur l’assemblée ; de mon temps ils avaient 1000 prétextes (je gouvernais constitutionnellement) ; mais à présent on voit trop le bout de leur oreille rouge, et la garde nationale et l’armée sauveront le pays malgré le pouvoir exécutif.
Adieu, mon cher général et ami, je vous attends dans quelques jours dans mon gouvernement provisoire, où nous vivons toujours comme de simples marchands de la cité.
Votre affectionné, L.-P., Comte de Neuilly.
Mémorial du 14 juin
Saint-Omer, 14 juin. – La dépêche télégraphique suivante, datée de Calais 13 juin, 7h30 du soir, a été adressée à Monsieur le sous-préfet :
« Le citoyen Louis Bonaparte vient d’être admis par l’Assemblée nationale comme représentant du peuple. Regardez comme non avenus les ordres dont il s’agit dans ma dépêche télégraphique d’hier. – Paris jouit de la plus parfaite tranquillité. »
Les ordres dont parle la dépêche étaient ceux d’arrêter le citoyen Louis Bonaparte partout où on le rencontrerait.
Mémorial du 17 juin
Depuis quelques jours, on disait que des troubles graves devaient éclater à Paris, et toute la ville attendait avec impatience les nouvelles de la capitale.
Les journaux font en effet connaître que Paris a été violemment agité par des émeutes occasionnées par l’élection, comme représentant du peuple, du prince Louis-Napoléon ; ces troubles n’ont pas eu la gravité que l’on pouvait craindre, puisque que les rassemblements se composaient en grande majorité de curieux.
Le résultat le plus clair de ces émeutes, pour la province, c’est qu’elles refoulent la confiance et rendent moins prochain le retour du commerce, dont la stagnation est un malheur public.
Nous voyons avec plaisir que l’Assemblée nationale s’est prononcée à une immense majorité pour l’admission de Louis Bonaparte. En effet, nous n’aurions pas compris que la loi de 1832, relatif au bannissement de la famille Napoléon, fut divisée en faveur des cousins du prisonnier du Ham et contre ce dernier. – Et d’ailleurs, recevoir dans l’enceinte législative l’auteur des comédies de Strasbourg et de Boulogne, c’est lui ôter tout caractère offensif. Le proscrire, en méconnaissant la volonté de ceux qui l’ont élu, c’eût été l’élever au rang de prétendant dangereux, lui donner le caractère intéressant qui suit le proscrit dans son exil.
– Aucun homme n’est de taille à porter convenablement au pouvoir le grand nom de Napoléon ; le téméraire qui tentera cette imprudence succombera sous le faix et perdra rapidement toute popularité. – Alexandre, César, Napoléon n’ont point eu de postérité ; chacun de ces grands capitaines, qui sont les 3 points les plus lumineux de l’histoire, n’a laissé qu’un fils unique, mort jeune, sans avoir pu recueillir la moindre part de puissance et de gloire personnelle.
– Un Napoléon peut bien arriver au pouvoir, il ne saurait y rester longtemps, son passage à la toute-puissance ne serait donc qu’une nouvelle étape de l’anarchie.
Mémorial du 21 juin
Monsieur le président a communiqué à l’Assemblée nationale, dans sa séance du 15 de ce mois, la lettre suivante, qu’il avait reçue la veille du prince Louis-Napoléon.
La lecture de cette lettre a produit un indicible tumulte dans l’assemblée.
« Monsieur le président,
je partais pour me rendre à mon poste, quand j’apprends que mon élection sert de prétexte à des troubles déplorables, et à des erreurs funestes. Je n’ai pas cherché l’honneur d’être représentant du Peuple, parce que je savais les soupçons injurieux dont j’étais l’objet. Je rechercherais encore moins le pouvoir. Si le peuple m’imposait des devoirs je saurais les remplir (bruyante agitation). Mais je désavoue tout ceux qui me prêtent des intentions que je n’ai pas. Mon nom est un symbole d’ordre, de nationalité, de gloire, et ce serait avec la plus vive douleur que je le verrais servir à augmenter les troubles et les déchirements de la patrie. Pour éviter un tel malheur, je resterais plutôt en exil. – Je suis prêt à tous les sacrifices pour le bonheur de la France. – Ayez la bonté, Monsieur le président, de donner connaissance de ma lettre à l’assemblée. Je vous envoie une copie de mes remerciements aux électeurs. – Recevez, etc.
Après la scène tumultueuse qui avait terminé la séance du 15, on s’attendait à des incidents passionnés, à quelque résolution énergique ; mais l’attente a été trompée. Monsieur le président Sénard a lu, à l’ouverture de la séance, une nouvelle lettre de Louis-Napoléon, par laquelle il déclare donner sa démission de représentant du peuple, donne-t-il aussi sa démission de prétendant ? Sa lettre semble le dire, l’avenir nous l’apprendra ! Voici cette lettre :
« Londres, 15 juin 1848.
Monsieur le président,
j’étais fier d’avoir été élu représentant du peuple, à Paris, et dans 3 autres départements. C’était, à mes yeux, une ample réparation pour 30 années d’exil et 6 ans de captivité ; mais les soupçons injurieux qu’a fait naître mon élection, mais les troubles dont elle a été le prétexte, mais l’hostilité du pouvoir exécutif, m’imposent le devoir de refuser un honneur qu’on croit avoir été obtenu par l’intrigue.
Je désire l’ordre et le maintien d’une république sage, grande et intelligente ; et puisque que involontairement je favorise le désordre, je dépose, non sans de vifs regrets, m’a démission entre vos mains.
Bientôt, j’espère, le calme renaîtra et me permettra de rentrer en France comme le plus simple des citoyens, mais aussi un des plus dévoués au repos et à la prospérité de son pays.
Recevez, Monsieur le président, l’assurance de mes sentiments distingués.
Louis-Napoléon Bonaparte
Mémorial du 28 juin
Saint-Omer, 28 juin. – Grâce au courage et au patriotisme français, le pays triomphe de ses ennemis. Paris a vu se jouer dans ses rues pendant plusieurs jours un drame horrible, mais la victoire est restée du côté des héroïques soutiens de la nation. Vive la république !
La garde nationale parisienne, la garde mobile, la garde républicaine, l’armée, les écoles et la jeunesse de la capitale ont sauvé la France de l’anarchie dans laquelle voulaient la plonger des misérables, la plupart sans aveu ou sortis des bagnes.
Les instigateurs de ces sanglants désordres ont maintenant perdu tout espoir, ils demeurent convaincus de l’inutilité de toute tentative nouvelle pour renverser l’œuvre du peuple, l’œuvre de tous. Ils sont bien incertains aujourd’hui que la France ne veut pas ce qu’ils veulent, une république mensongère, anarchique, sanguinaire, spoliatrice.
Quant aux séides qui rêveraient encore un autre gouvernement que le gouvernement populaire, qu’ils cessent de caresser leur idole, le glas funèbre de ce qu’ils appellent la légitimité a sonné pour la 3e fois avec celui des prétendants de toutes les nuances. Les noms de Henri V, d’Orléans, de Joinville ou de Nemours ne sont à l’heure qu’il est que de misérables anachronismes, et celui de Napoléon n’est qu’une sotte dérision digne de pitié.
Tout le pays a pris part à cette grande manifestation en faveur du maintien des institutions de Février. Toutes les villes qui ont pu le faire ont envoyé à Paris des détachements de gardes nationaux, et Saint-Omer n’est pas resté en arrière dans ce mouvement de courageux dévouement à la sainte cause du pays. – Le rappel a été battu ici dimanche dans la matinée, et bientôt le bataillon était sur pied et de ses rangs sortaient des citoyens qui s’apprêtaient à marcher sur la capitale.
Vers 5 heures nos braves camarades au nombre de 130 étaient conduits solennellement au lieu du départ par la garde nationale et précédés du corps de musique de la garnison. De la place d’armes à l’avenue d’Arques, des chants patriotiques, entonnés avec enthousiasme, n’ont cessé de se faire entendre. À 6 heures environ ils sont montés dans les voitures du train des équipages, et au signal de Monsieur le commandant de la garde nationale qui les accompagnait, ils sont partis aux acclamations de la foule.
Récit des journées de juin à Paris par le Mémorial Artésien.
Journée du 23.
Dès le point du jour des barricades s’élevaient dans les quartiers Saint Antoine et Saint-Marceau ; le faubourg Saint-Antoine particulièrement avait été transformé en place de guerre. – À 9 heures Paris était encore assez calme et cependant on voyait déjà 2 barricades à la porte Saint-Denis, une à la porte Saint-Martin, une rue de l’Échiquier, une à l’entrée du faubourg du Temple, une rue de la Planche-Mibrai, 4 ou 5 dans les rues avoisinant l’Hôtel de Ville, une rue Saint-Antoine, en face de l’église Saint-Paul une à l’entrée de la rue de la Roquette, une à l’entrée du faubourg Saint-Antoine, 30 aux points importants de la Cité, de l’île Saint-Louis, du faubourg Saint-Jacques et du faubourg Saint-Marceau.
La plus formidable était celle du faubourg Saint-Antoine. Elle commandait la place de la Bastille. On l’avait surmontée d’un énorme drapeau rouge.
C’est à 10 heures seulement que les forces décidées à défendre l’ordre contre cette nouvelle tentative commencent à s’organiser. À 11 heures, le mouvement commence contre l’insurrection, qui avait passé la nuit à se forger ces armes et ces redoutables moyens de défense, et qui, postée derrière les barricades terminées, maîtresse des maisons qui formaient encoignures là où la lutte paraissait devoir être plus acharnée, échangeait des signaux et semblait provoquer les 900 000 âmes de population saine que renferme Paris.
Depuis 3 quarts d’heure les bannières des ateliers nationaux étaient plantées çà et là. On préludait au combat en dépouillant quelques gardes nationaux isolés, ou en crevant les caisses des tambours chargés de rappeler les légions. Les insurgés prirent des postes pour se procurer des armes. Le boulevard Bonne-Nouvelle et la rue de Cléry ont surtout souffert de ces visites.
Enfin, à 11h30, les gardes nationaux s’avancent résolument sur les premières barricades des boulevards. La barricade de la porte Saint-Martin est enlevée en un instant. 10 minutes plus tard, un autre détachement de gardes nationaux paraît à la sortie de la rue de Cléry et commence le feu contre la barricade de la porte Saint-Denis.
Un porte-drapeau se tenait fièrement debout sur les dernières pierres, un drapeau à la main, excité par 2 femmes, restant après la fuite des défenseurs de la position. Blessé par une décharge, il se relève et agite son drapeau. Un autre coup de feu le tue.
Nous renonçons à peindre l’aspect de la mêlée. Jusqu’à 3 heures, le feu a continué aux abords de la porte Saint-Martin et de la porte Saint-Denis. Des cadavres en grand nombre étaient étendus sur le sol ; les blessés étaient recueillis dans les maisons voisines. On tirait des fenêtres et du monument de la porte Saint-Denis.
À 3 heures pourtant, on se trouve maîtres des boulevards, jusqu’à la porte Saint-Antoine. Les quais, les ponts, le Luxembourg, l’Assemblée nationale étaient occupés et entourés par des troupes à pied et à cheval. À ce moment, un orage éclate sur Paris, et rend le service important de débarrasser la voie publique de tout ce qui n’est pas insurgé ou défenseur de l’ordre.
À 4 heures, les troupes attaquent une barricade au Château-Landon, rempart formé de matériaux devant servir au chemin de fer de Strasbourg. Les balles étaient impuissantes devant un tel obstacle. À 5 heures, 4 coups de canon enfoncèrent cette barricade.
À 6 heures on entend toujours des feux de pelotons très nourris du côté du faubourg Saint-Jacques. Un engagement très sérieux a lieu dans cette direction entre les insurgés et les troupes. La rue Saint-Jacques se trouve coupée dans toute sa longueur par de nombreuses barricades. Les maisons sont parfaitement gardées par l’émeute et converties en de véritables forteresses. On tire de toutes les fenêtres sur les troupes. Là encore il faut le canon pour se rendre maître des positions.
À 7 heures, des patrouilles nombreuses battaient la ville dans tous les sens.
Le canon tonne toujours du côté du faubourg Saint-Jacques. Une seule barricade reste encore à enlever.
La fusillade ne se ralentit pas un seul instant. La mitraille balaie la rue. Des combats partiels ont lieu dans toutes les petites rues aboutissantes. La garde nationale se montre très énergique et très décidée.
À 9 heures, la garde nationale, la troupe de lignes, la garde mobile, la garde républicaine se développent sur toute la ligne des quais. Les ponts sont gardés ; on ne les traverse le plus ; toute communication entre les 2 rives de la Seine est rigoureusement interdite.
À 11 heures, on évalue à 1000 le nombre des personnes tuées ou blessées pendant cette journée, la plus terrible et la plus meurtrière que Paris ait vue depuis 30 ans.
Personne ne peut dire si la journée de demain ne sera pas plus effrayante encore !
À minuit les insurgés sont toujours maîtres de la place de la Bastille et de ses abords. Une fusillade très vive s’engage entre eux et la troupe. – La garde nationale, la garde mobile, la ligne, la cavalerie (cuirassiers, dragons et lanciers) occupent en masse compacte toute la ligne des boulevards, depuis la rue du Temple jusqu’à l’angle de la rue Montmartre. La fusillade continue dans plusieurs quartiers à la lueur de l’incendie. – Un engagement a eu lieu du côté du chemin de fer du Nord.
Monsieur Bixio est blessé mortellement.
Le général Bedeau a reçu une balle dans la jambe. Il a quitté le commandement. On croit qu’il est remplacé par le général Lamoricière.
La barricade de l’Hôtel-Dieu, après un combat sanglant, est tombée au pouvoir de la ligne.
Journée du 24
À 2 heures, le canon et la fusillade continuent sur les points indiqués ci-dessus.
À 3 heures des engagements meurtriers ont lieu auprès de la place de la Bastille. Plusieurs pièces d’artillerie, placées sur les boulevards, cherchent à détruire la barricade. Un vaste magasin de nouveautés, les deux Pierrots, situé au coin des rues de la Huchette et de la Vieille-Bûcherie, est envahi par les insurgés qui en font leur quartier général.
À 4 heures, la garde mobile s’avance sur le Petit-Pont et sur la place, et fait feu sur la maison. Le combat dure une bonne heure. – L’artillerie donne ensuite. – Les insurgés se retranchent jusque dans la rue Saint Séverin, puis ils s’emparent de l’église, sonnent le tocsin et veillent aux barricades qui s’élèvent autour d’eux – la générale bat de tous les côtés.
À 5 heures le canon gronde dans le faubourg du Temple. Au fur et à mesure que l’on s’empare d’une barricade, on en retrouve une autre mieux organisée. Les victimes du côté des troupes et de la garde nationale sont très nombreuses. – Le faubourg Saint-Antoine continu toujours à se battre.
À 6 heures, un grand nombre d’insurgés se portent vers la gare du chemin de fer du Nord, et après une longue et opiniâtre résistance de la part des troupes et de la garde nationale, ils s’emparent de la gare et détruisent les rails. – On assure que beaucoup de gardes nationaux des provinces du Nord avancent sur Paris.
À 7 heures, les rues sont cernées et la circulation est très difficile, surtout du côté de l’hôtel des Postes.
À 8 heures, le Palais-National est parfaitement calme.
À 9 heures, l’Assemblée nationale est occupée comme hier par les troupes. – Le faubourg Saint-Marcel tient toujours contre les troupes. – Le pouvoir exécutif croit que dans quelques heures tout rentrera dans l’ordre accoutumé. Des mesures énergiques partent du ministère de l’intérieur. – Le général Cavaignac fait annoncer sur tous les points où sont les insurgés, qu’il accorde une heure pour terminer cette bataille sanglante. Que ce délai expiré, le canon détruira et les barricades et les maisons qui donneront asile aux insurgés. Jusque-là chacun peut se retirer chez lui. Il ne sera nullement inquiété. – Les insurgés refusent. – Pendant cette heure les troupes s’organisent pour commencer une bataille qui sera sans doute horriblement meurtrière. – Le calme qui règne pendant cette heure fait croire aux gardes nationaux des quartiers éloignés des faubourgs que tout est terminé.
À 11 heures, la trêve expirée, le canon gronde de tous côtés, des barricades s’élèvent aux halles ; la fusillade s’engage avec acharnement. Les insurgés ont pénétré dans St.-Méry ; le canon est pointé sur cette église.
A midi, on n’entend de toutes parts que le canon et la fusillade.
À 2 heures, la garde mobile réunie à la garde nationale répondait depuis 1h30 au feu des insurgés retranchés derrière une barricade élevée dans la rue Beaubourg.
Après de nombreux coups de feu échangés, la barricade a été enlevée au pas de course.
Dès le matin, les insurgés avaient pris possession du Panthéon et de l’École de droit, où ils ont pillé tout ce qui avait quelque valeur.
C’est vers 1h30 que le 7e léger, le 18e bataillon de la mobile et des détachements de divers corps de l’armée et de la garde nationale se sont emparés du Panthéon, dont les insurgés avaient fait une véritable place forte. Après plusieurs tentatives inutiles pour les débusquer de cette formidable position, il a été nécessaire de recourir à l’artillerie pour enfoncer les portes du monument, dont la solidité défiait toute autre tentative.
Les canons étaient braqués à l’entrée de la rue Neuve Soufflot, et plus de 50 coups ont dû être tirés.
Aussitôt que les portes ont ouvert un passage, la brave garde mobile, suivi du 7e léger et de toutes les autres troupes présentes, s’est précipitée par cette brèche.
Les insurgés les attendaient de pied ferme à l’intérieur, et ce n’est qu’après la plus vive fusillade qu’on est parvenu à se rendre maître de la place.
Plus de 1200 arrestations ont été faites, tant dans les caves que dans les combles et dans tous les endroits qui pouvaient offrir une retraite.
À 4 heures, l’état de siège rend les communications difficiles, sinon impossibles. – Le bruit court que les gardes nationaux de Rouen viennent d’arriver. Plusieurs légions de la banlieue font leur entrée en ville. – Après une canonnade meurtrière, la barricade de la rue de Rambuteau vient d’être renversée.
À 5 heures, les gardes nationales de Meulan, Vitry, Arcueil et Villejuif débouchent sur la place, leur colonel en tête, et viennent se ranger en bataille devant le monument.
À 6 heures du soir, 800 insurgés ont été forcés de se rendre, et ils ont été dirigés sur les Tuileries par la rue de Richelieu ; ils marchaient quatre à quatre, escortés de chaque côté d’une triple haie de gardes nationaux. Aucun cri ne se faisait entendre sur leur passage.
À 7 heures, la garde nationale et l’armée sont maîtresses de presque toutes les positions. On dit que les insurgés sont retranchés dans l’île Saint-Louis et sont déterminés à une vigoureuse résistance.
À minuit toutes les rues sont gardées, les sentinelles font entendre, de 5 en 5 minutes, le cri : Sentinelles prenez garde à vous ! La circulation est interdite. On est obligé de se faire escorter pour rentrer chez soi.
On n’entend aucun bruit de fusillades suivies. Les insurgés aurait, dit-on, abandonné leurs barricades du Faubourg-du-Temple. – Quelques coups isolés produisent seulement de temps à autre de vives alertes.
Journée du 25.
La situation est plus rassurante. La rive gauche de la Seine est au pouvoir des troupes de la république. Les insurgés conservent 5 points importants. Ce sont les barrières Poissonnière, Saint-Martin, Saint Denis, les Faubourg-du-Temple et Saint-Antoine.
Aux barrières, le feu, d’un commun accord, est à peu près suspendu ; cependant quelques balles arrivent jusqu’à l’église Saint-Vincent-de-Paul.
Au Faubourg-du-Temple, le feu continue entre des tirailleurs républicains et les insurgés, placés derrière une barricade formidable, élevée à demi-portée de fusil au-delà du canal Saint-Martin. Une pièce de canon protège le feu des républicains.
Pour attaquer ces 5 positions à la fois le général Lamoricière attend des renforts. On pourrait prendre l’offensive ; mais l’action sera moins meurtrière et le succès plus prompt si l’on marche à l’ennemi en colonnes serrées.
Vers une heure après-midi, la garde nationale de Saint-Denis arrive, ainsi que le détachement de la compagnie d’artillerie de la garde nationale d’Arras avec 150 hommes des autres compagnies de la région.
Paris est calme il attend sans trop d’anxiété l’heure du combat. Peu de citoyens circulent ; on voit plus de femmes que d’hommes ; on en a arrêté quelques-unes qui portaient de l’argent qu’on supposait destiné aux insurgés.
Les insurgés, au nombre de 25 000, occupent tout le faubourg Saint-Antoine, qu’ils ont sillonné de barricades gigantesques. On aura fort à faire pour les déloger de cette position, car ce n’est pas seulement une guerre de rue qu’on aura à soutenir, mais une guerre de maisons dont on sera obligé de faire le siège.
Nous ne pensons pas que l’attaque générale contre les points principaux au pouvoir de l’insurrection commence avant demain matin. La bataille sera rude, car l’acharnement et égal des 2 côtés ; mais l’ordre et la liberté, qui sont du côté de la république, auront promptement raison des factieux.
Paris 26 juin 1848,2 heures du soir.
Le chef du pouvoir exécutif aux préfets et sous-préfets.
Le faubourg Saint-Antoine, dernier point de la résistance, est pris. – Les insurgés sont réduits, la lutte est terminée. L’ordre a triomphé de l’anarchie.
Mémorial du 1er juillet
Saint-Omer, 1er juillet. – Le détachement de notre garde nationale, qui s’était rendu à Paris pour y défendre la république attaquée par l’anarchie, est rentré dans nos murs au milieu d’un enthousiasme difficile à décrire. – La garde nationale tout entière, les autorités civiles et militaires, le lycée, musique en tête, les écoles communales, le pensionnat Saint Bertin s’étaient portés jusqu’à Arques à la rencontre de nos braves camarades, qui ont été reçus en ville par d’unanimes acclamations au milieu d’une foule immense, au son des cloches, aux cris 1000 fois répétés de vive la république ! Le drapeau tricolore était à toutes les fenêtres. – Les rues d’Arras, de La Fayette, des Epéers, la Petite-Place, la rue des cuisiniers, la Grande-Place, parcourues par le cortège, étaient illuminées.
Des vins d’honneur ont été offerts aux volontaires Audomarois, par la mairie, dans le grand salon de l’hôtel de ville ; puis, à la clarté des torches la garde nationale a défilé devant le détachement en le saluant des plus vives, des plus énergiques, des plus patriotiques acclamations ! – Les compagnies ont ensuite reçu en particulier leurs camarades et leur ont renouvelé les expressions de leur attachement et de leur reconnaissance pour les avoir si bien représentées à Paris, dans la défense de l’ordre et de la liberté.
Mémorial du 8 juillet
Mort de Châteaubriand le 4 juillet.
Le 15 juillet, relation des obsèques de Châteaubriand, à partir de son domicile 112 (ou 110, d’après Victor Hugo dans « Choses vues »)) rue du Bac.
Le Mémorial publie la célèbre Préface Testamentaire. Châteaubriand est mort dans un siècle qui n’était plus le sien.
Mémorial du 9 août
Monsieur Lamartine dit à tout le monde qu’il y a un mot d’ordre contre lui et qu’on veut le tuer (moralement bien entendu) parce qu’il est… Républicain.
– Allons donc, répondait un général auquel on répétait ce propos, Monsieur Lamartine est républicain comme il était légitimiste lorsqu’il faisait l’ode sur le sacre, comme il était conservateur philippiste lorsqu’il défendait Monsieur Molé, comme il était régentiste le 22 février ; Monsieur Lamartine est un poète politique, il prend ses rêves pour des croyances, et quand il dit qu’on veut le tuer, il se trompe il confond l’homicide avec le suicide.
Mémorial du 23 août
Napoléon Bonaparte est élu dans le département de la Seine
Monsieur Louis Bonaparte n’arrivera, dit-on, à Paris, qu’après la vérification des pouvoirs
Mémorial du 27 août
si nous en croyons les versions qui circulent, un grand nombre de représentants seraient d’avis de presser le vote de la constitution avant l’admission de Louis-Napoléon.
Leur but est de faire décider que l’élection du président de la république aurait lieu par l’assemblée elle-même. L’attitude prise, dit-on, par certains partisans de Louis-Napoléon, aurait provoqué cette résolution.
On fait courir toutes sortes de bruits, sur la manière dont Louis-Napoléon Bonaparte se présentera l’assemblée. Suivant les uns, il arrivera simplement par une porte de derrière, sans chercher à se faire remarquer ; suivant d’autres, il fera son entrée en souverain, et sera escorté de tous les vieux soldats de l’empire qu’on a remarqué le 5 mai aux Invalides et autour de la colonne Vendôme. Pour notre compte nous ne savons à quelle conjecture nous arrêter ; les 2 cousins ne paraissent plus aux séances, viendront-ils présenter eux-mêmes Louis-Napoléon ! Quoi qu’il en soit, une grande anxiété règne dans le public et nous craignions bien que 2 échauffourées successives n’aient pas guéri de ses folles prétentions le héros manqué de Strasbourg et de Boulogne.
Mémorial du 11 octobre
le citoyen Louis Bonaparte a visité aux Invalides, le tombeau de l’empereur Napoléon, son oncle, qu’on termine en ce moment.
Le château de Claremont réunit en ce moment presque toute la famille de l’ex roi des Français. Le 6 octobre est l’anniversaire de Louis-Philippe, qui a atteint ce jour-là sa 75e année, et l’on sait que la famille d’Orléans ne manquait jamais de se réunir chaque année au retour de cet anniversaire.
Dans sa séance du 7 octobre, l’Assemblée nationale a décidé que le président de la république sera élu au suffrage universel. L’exercice de son droit suprême imposera à la nation un immense devoir à remplir, elle le comprendra sans doute et agira en conséquence.
Mémorial du 14 octobre
L’assemblée a adopté, à l’unanimité et sans discussion, un projet de décret portant abrogation de l’article 36 de la loi du 10 avril 1832, relatif au bannissement des membres de la famille Bonaparte.
Mémorial du 25 octobre
Le prince Louis Napoléon Bonaparte s’est fait inscrire comme membre du comité de l’Instruction publique. Il a refusé de déférer aux vœux de ses amis qui désiraient le faire inscrire au comité des affaires étrangères ou à celui de la guerre.
Mémorial du 1er novembre
Nous voici à la veille d’un second et décisif essai du suffrage universel ; n’est-il pas permis d’espérer que ce nouvel acte de la souveraineté de la nation portera le sceau d’un consciencieux examen, d’un dévouement éclairé envers la France ?
N’est-il pas permis d’espérer que dans la chaumière comme dans l’atelier, dans les campagnes comme dans les villes, chaque citoyen aura le sentiment de sa haute mission et voudra consulter sa conscience et non son imagination, la réalité et non l’inconnu ?
N’est-il pas permis d’espérer que la majorité aura le courage de ses convictions lorsqu’il s’agira de l’existence de la famille, des garanties de la propriété et du travail ; du bien-être ou de la misère ; de la tranquillité publique ou de la guerre civile ?
Bien que nous marchions encore au milieu des tempêtes et des écueils, et que nous ne nous dissimulions pas les périls de la situation, l’espoir ne nous abandonne pas ; nous ne croyons pas, en un mot, qu’un membre de la famille de l’empereur ait été choisi par la fortune, dans un jour de caprice, pour peser sur les destinées de la France.
En effet, on se demande en vain quels sont les titres qui distinguent de ses cousins le prince Louis-Napoléon ; on cherche vainement ces titres qui pourraient fixer sur lui l’attention de la France et porter le pays à remettre entre ses mains l’avenir, le salut de la République.
Comment la France, qui en 1840 ne voulait pas de Louis-Napoléon pour remplacer Louis-Philippe, en pourrait-elle vouloir en 1848 pour président ?
La royauté ne devait être alors (on le prétendait du moins) qu’une fiction constitutionnelle ; le roi régnait, mais il ne gouvernait pas ; il n’était pas responsable. Le président de la République, au contraire, portera la responsabilité de ses actes. – Par quel revirement d’opinion, par quelle faute contre la logique et le bon sens pourrait-il donc arriver qu’on fit un président responsable d’un homme dont on ne voulait pas, en 1840, pour un monarque sans responsabilité personnelle !
Si la réponse était affirmative, si le prince Louis était porté à la présidence par le suffrage universel, nous serions forcés de nous écrier : « ainsi les destins l’ont voulu ! Ce sont eux qui ont prononcé, mais ce n’est pas le sens droit, le libre suffrage de la France ! – Un voile est descendu sur le jugement des citoyens ; ils ont fermé les yeux et, au hasard, ils ont résolu la question en aveugles. »
Mais avant d’en venir à d’inutiles regrets, ne devons-nous pas jeter à temps le cri d’alarme et prémunir les citoyens contre l’erreur qui pourrait tenter de les égarer ?
Monsieur Louis-Napoléon ne doit le bruit qui se fait autour de lui et à propos de lui, il ne doit l’importance qu’il a prise parmi les héritiers du nom de Napoléon, qu’aux deux ridicules échauffourées de Strasbourg et de Boulogne ; sans l’éclat malheureux de ces deux mauvaises plaisanteries, personne en France ne songerait à lui en ce moment.
Depuis ces deux tentatives avortées, Monsieur Louis-Napoléon est resté ce qu’il était, son intelligence n’a pas grandi ; il ne sait pas plus qu’il ne le savait jadis ce que demande, ce que veut le pays.
Nommé représentant du peuple, mais inférieur par le talent à un grand nombre de ses collègues, il ne lui suffit pas de déclarer à la tribune de l’Assemblée nationale « qu’il accepte la candidature de la présidence de la République, parce qu’il est autorisé à croire que la France regarde le NOM qu’il porte comme pouvant servir à la consolidation de la société ébranlée ; » non, certes, cela ne suffit pas, car si le prestige d’un nom comme celui de Napoléon peut attirer des votes irréfléchis vers l’homme qui s’en arme par le droit de naissance, ce nom ne donne pas au prince qui en est paré les capacités essentielles à tout candidat à la présidence de la République.
Tel on jugeait Monsieur Louis-Napoléon après Strasbourg et Boulogne, tel, si pas plus sévèrement encore, il faut le juger aujourd’hui.
« Les faits parlent suffisamment, disait le 8 août 1840, le journal la Presse qui avait en ce temps-là, à notre avis, parfaitement raison ; Monsieur Louis-Napoléon s’est placé dans une position telle que nul en France ne peut honorablement éprouver pour sa personne la moindre sympathie, ni la moindre pitié.
– Le ridicule est dans l’avortement si misérable de ses projets, dans sa fuite précipitée dès le premier signe de résistance ; – l’odieux est dans l’ingratitude qui oublie qu’une fois déjà la clémence royale a pardonné généreusement un crime qu’on avait le droit de punir des peines les plus sévères, et que Napoléon eut fait expier chèrement à ses auteurs… Mais laissons ce jeune homme qui ne paraît pas avoir plus d’esprit que de cœur…
A-t-il été plus habile à Strasbourg ? – A-t-il été plus habile en Suisse, alors que pour échapper à une expulsion, il ne rougissait pas de faire soutenir, par ses amis de la Diète, qu’il n’était plus citoyen français, qu’il était citoyen de Turgovie, et qu’à ce titre la France ne pouvait exercer aucun droit contre lui ? Enfin, a-t-il été plus habile durant son séjour à Londres, lorsque paradant au ridicule tournoi d’Eglington, où étalant chaque soir sa nullité parmi les dandys du balcon de Drury-Lane, il ne savait recommander son nom que par des exploits dignes tout au plus du journal des Modes ? »
Et le journal la Presse, sincère alors dans son appréciation du caractère du prince aujourd’hui prétendant à la présidence de la République, finissait son anathème en ces termes : « il n’est pas même un chef de parti ; il n’en est que la méchante caricature. »
Tel était le langage de la Presse qui disait alors sa vérité vraie ; aussi en face des graves besoins de la République, nous repoussons, autant qu’il est en nous de le faire, la candidature du prince Louis-Napoléon, et nous disons avec tous les esprits justes et droits que n’égare pas le parti pris d’aggraver la situation, afin de pouvoir plus tard, suivant une expression vulgaire, pêcher en eau trouble aux dépens de la patrie ; nous disons :
Voter pour Louis-Napoléon en haine d’une autre candidature ;
Voter pour le prétendant de Strasbourg et de Boulogne pour user toutes les transitions ;
Chercher à assurer, même malgré ses convictions, une majorité à cette présidence ;
C’est livrer la France à tous les hasards de l’inexpérience ;
C’est exposer la patrie aux effroyables chances d’une guerre civile ;
C’est manquer à sa conscience ;
C’est prendre, pour l’avenir, la plus terrible des responsabilités. Signé : G. F.
Mémorial du 8 novembre
le Moniteur de l’Armée vient de publier la biographie du général Cavaignac ; nous en extrayons les lignes suivantes qui diront assez clairement quelle candidature nous espérons voir triompher lorsque le suffrage universel aura à nommer le président de la République.
Mémorial du 11 novembre
Monsieur Thiers se prononce contre la candidature du général Cavaignac, adoptée généralement par le parti d’ordre et de modération, et qui pourrait contrarier le sentiment populaire qui, suivant Monsieur Thiers, pousse invinciblement Monsieur Louis-Napoléon à la présidence.
Mémorial du 15 novembre
Circulaire adressée par Monsieur le préfet du Pas-de-Calais à Messieurs les maires de ce département
Arras, 7 novembre 1848
Monsieur le maire,
Un décret de l’Assemblée nationale a fixé au 10 décembre prochains l’élection du président de la République. Je n’ai pas besoin de vous dire toute l’importance du grand acte de souveraineté populaire que la France va être appelée à accomplir. Il s’agit pour elle de constituer un pouvoir exécutif, désormais temporaire et responsable. Vous savez, comme moi, l’influence que le choix du chef de l’État exercera sur les destinées du pays, et vous comprendrez combien il importe que chaque citoyen s’y prépare avec recueillement, avec intelligence, avec patriotisme.
… Et vous me permettrez d’emprunter ici la pensée même exprimée par Monsieur le ministre de l’intérieur dans une récente circulaire, la nation doit, dans le choix qu’elle fera, « se confier à un passé sans reproche, à un patriotisme incontestable, à une résolution mâle, énergique, déjà éprouvée au service de la République, plutôt qu’à de vaines et trompeuses promesses. »
Mémorial du 22 novembre
Au vœu du décret de l’Assemblée nationale et des instructions de Monsieur le ministre de l’intérieur, la Constitution a été promulguée à Saint-Omer, dimanche dernier, avec toute la solennité possible.
Élection du président de la république
circulaire de Son Éminence le cardinal évêque d’Arras, au clergé de son diocèse.
Arras le 11 novembre 1848
Très chers coopérateurs,
Le clergé est appelé à concourir à l’élection du président de la République française.
Comme citoyens et comme ministres des autels du Dieu vivant, nous ne devons nous proposer d’autre but que le bien véritable de notre chère et belle patrie.
Songeons que si le doigt de Dieu s’est manifesté d’une manière remarquable dans la révolution du 24 février, nous devons oublier la part que quelques hommes ont voulu y prendre pour en faire leur œuvre et leur profit ;
… Défions-nous avec soin des vaines jactances de quelques hommes, de leurs fallacieuses promesses ; et choisissons l’homme que l’amour de notre patrie et notre sagesse nous inspirerons d’élire.
Plusieurs de vos confrères m’ont demandé qui je choisirai… Voici la réponse que je me suis permise : « l’éducation que j’ai reçue m’a appris que la reconnaissance était la vertu de l’âme honnête et généreuse ; je n’oublierai jamais notre délivrance de l’insurrection du mois de juin dernier ; du reste, je suis le fils d’un homme d’épée ; j’ai porté moi-même les armes un instant : JE VOTERAI POUR UN SABRE. Je connais la France, je croirais la servir ainsi et lui prouver que je l’aime comme elle le mérite… »
Le général Cavaignac a le soutien de l’Église.
Mémorial du 2 décembre
Saint-Omer, 2 décembre. – Le comité électoral républicain de Saint-Omer vient de se décider à l’unanimité pour la candidature du général Cavaignac, comme celle la plus propre à asseoir solidement la république et à préserver la France des horreurs de la guerre civile et de l’anarchie.
Nous sommes autorisés à démentir de la manière la plus positive un article itérativement publié dans le journal la Presse et qui tend à faire croire que le général Cavaignac est protestant ainsi que son père. – Le général est catholique, la Presse seule pouvait inventer une pareille calomnie.
Mémorial du 9 décembre (veille de l’élection du président de la République)
Pour être conséquente avec elle-même, la France doit, dans cette circonstance solennelle, émettre un vote qui ne soit l’abdication de la République modérée que nous possédons, en faveur d’un avenir gros de nuages et de tempête, et qui se personnifie en Monsieur Louis-Napoléon Bonaparte.
Mémorial du 13 décembre
les premiers résultats arrivent : à Saint-Omer, le général Cavaignac l’emporte avec 3722 voix contre 2959 à Louis-Napoléon Bonaparte.
À Aire, le général Cavaignac l’emporte également par 2176 voix contre 1465.
Mais pour Saint-Omer et son arrondissement total, Louis-Napoléon Bonaparte l’emporte avec 12 675 voix contre 9335 pour le général Cavaignac.
Mémorial du 16 décembre
les résultats de l’élection présidentielle pour le département du Pas-de-Calais donnent
100 676 voix à Louis-Napoléon Bonaparte contre
39 695 pour le général Cavaignac
Mémorial du 23 décembre
Monsieur Louis-Napoléon Bonaparte qui, sur 7 326 000 votants, a obtenu 5 434 000 suffrages, a été proclamé par l’Assemblée nationale président de la République française. Cette cérémonie d’inauguration a été simple, touchante et solennelle.
Monsieur Waldeck-Rousseau ayant fait connaître le résultat général de l’élection, l’assemblée tout entière s’est levée, moins 5 ou 6 membres de la montagne, pour adopter les conclusions du rapport.
Avant que le président fut proclamé, Monsieur le général Cavaignac est monté à la tribune pour annoncer qu’il venait de recevoir la démission de tous les ministres et pour déposer les pouvoirs qu’il avait reçu lui-même de la confiance de l’assemblée. La dignité de ses sentiments, de son langage et de son attitude a provoqué, au sein de l’assemblée, des applaudissements qui l’ont suivi jusque sur le banc où il a été s’asseoir au milieu des représentants ; l’émotion était générale et très vive.
Proclamé président de la République au nom du Peuple français et de l’Assemblée nationale, Louis-Napoléon Bonaparte, portant sur son frac noir, les insignes de grand-croix de la Légion d’Honneur qu’il a reçus de l’empereur, est monté à son tour à la tribune pour prêter serment. À la lecture de la formule qui engage son honneur et son dévouement, il a répondu d’un ton ferme, la main levée vers le ciel : « je le jure ! » Puis, au milieu d’un profond silence, il a donné lecture du discours suivant, remarquable par un caractère de droiture et de sincérité qui lui a concilié l’approbation de toute la chambre.
« Citoyens représentants, les suffrages de la nation, en m’appelant à la présidence, m’imposent aussi des devoirs. J’observerai le serment que je viens de prêter comme doit le faire un homme d’honneur. Je regarderai comme ennemi de la patrie tout homme qui tentera de troubler l’ordre de la République et de changer ce que la France a établi. Entre vous et moi, citoyens représentants, il ne saurait y avoir de véritable dissentiment. Je veux, comme vous, fonder la République, maintenir et rassurer la société, améliorer nos mœurs par des institutions démocratiques. Avec la paix et l’ordre, nous ramènerons les hommes égarés, nous calmeront les passions, nous soulagerons les populations malheureuses. J’ai appelé auprès de moi des hommes honnêtes, quoi que d’opinions diverses. Ils concourront avec nous au perfectionnement des lois, à la gloire de la République.
La nouvelle administration doit des remerciements à celle et qui l’a précédée pour lui avoir remis le pouvoir intact. La conduite du général Cavaignac a été digne de la loyauté de son caractère ; je le remercie publiquement des grands services qu’il a rendus à la France. Une grande mission nous reste à remplir, c’est de fonder une République sage et honnête. Animés par le sincère amour de la patrie, nous suivrons toujours la voie du progrès sans être réactionnaires ni utopistes, et nous ferons du moins le bien, si nous ne pouvons faire de grandes choses. »
En descendant, et avant de se rendre au palais de l’Élysée, où il devait être conduit par le bureau et par une escorte d’honneur, il a traversé la salle, et montant rapidement les degrés qui conduisent au banc où venait de s’asseoir le général Cavaignac, il lui a prit la main et lui a adressé quelques paroles avec effusion. Alors les acclamations ont éclaté de toutes parts. Ce mouvement généreux a été salué par les représentants et par le public comme le signe heureux de la conciliation des parties et de l’affermissement des institutions nouvelles. – L’assemblée s’est levée aux cris répétés de : Vive la République.
Louis Bonaparte, à ce qu’on nous assure, aurait dit au général Cavaignac, à qui déjà il venait de rendre un hommage mérité dans son allocution publique : « Général, quel qu’ait été le résultat de la lutte électorale, votre nom et vos actes rempliront une noble page de l’histoire de notre pays, et j’espère que cette page ne sera pas la dernière. »